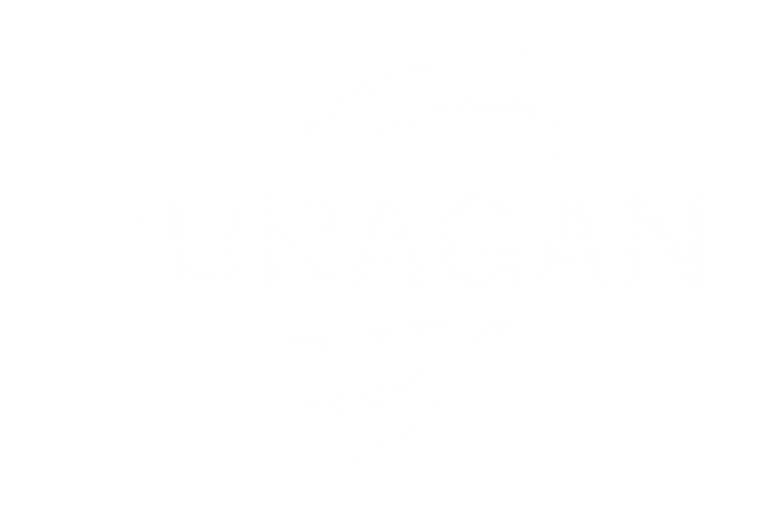Julie Grimoud, professeure de Lettres au lycée français de Kinshasa, metteuse en scène et auteure, publie “Parallèles” aux éditions Studio 1960. Le livre exploite les mémoires personnelles et collectives entre la France et la RDC. Grâce à son œuvre, Grimoud pose un regard critique sur les similitudes et les différences entre ces deux pays selon sa propre perception.
Julie Grimoud : “les médias en France nourrissent une vision complètement fausse de la RDC”
Julie Grimoud est professeure de français et auteure du livre “Parallèles” publié aux éditions Studio 1960 @Photo Droits tiers.
“Parallèles” est un livre dont la musicalité retentit dans une écriture remplie de poésie. Dans quelle catégorie mettre cet ouvrage ? On cherchera en vain la réponse. Un très bel exercice, d’ailleurs. Ce qui est sûr, Julie Grimoud sait écrire, classer les mots avec l’équerre. Son écriture est un plongeon dans les eaux saisissantes de plusieurs genres. Ce livre est une invitation qui va à la rencontre de ce qu’elle appelle “une tentative de déconstruction”. Quoi déconstruire ? Certaines images qu’on colle à l’Afrique, précisément à la RDC. L’ouvrage a pris corps grâce à son voyage dans la province du Kwilu, précisément à Kikwit et Feshi. Les paysages contemplés, les routes parcourues et les personnes rencontrées ont fait surgir dans sa mémoire des souvenirs lointains, la poussant à des réflexions sur l’écriture, la colonisation…
Ouragan : Une question surgit en parcourant ce livre. Dans quelle catégorie peut-on le classer puisqu’il contient plusieurs genres, entre autres la poésie, l’essai, le récit de voyage…?
Julie Grimoud : Ce n’est pas à moi de le catégoriser. Je pense que ce livre est simplement le récit d’une expérience et d’une réflexion personnelle, qui, comme cela se fait de plus en plus dans la littérature actuelle, casse (ou tente de casser) les codes traditionnels. L’écriture (l‘art en général) est ce qui échappe aux catégories pour faire place à d’autres voix, singulières, divergentes de la pensée commune, de la doxa.
Pour écrire ce livre, vous avez écouté du jazz, plus précisément la musique de Thelonious Monk. Qu’est-ce que vous trouvez d’original chez lui ?
Comme je le dis dans le livre, le jazz est un héritage de mon père. Plus spécifiquement, la musique de Thelonious Monk, le père du Bebop. C’est une musique qui réinvente complètement les codes du jazz traditionnel, qui décale les rythmes pour faire entendre autre chose. Thelonious Monk avait un esprit très particulier, qui sortait de toutes les normes, de toutes les classifications. Et qui en même temps faisait entendre un “ailleurs”, autre chose, un univers que personne n’avait jamais entendu. Mon père écoutait et jouait énormément Monk. Il le joue toujours, malgré sa perte de mémoire. Ça reste. Je crois qu’il y avait une connexion entre lui et ce musicien : mêmes étrangetés au monde normal, aux règles sociales. Monk, pour moi, c’est un peu cet héritage-là, cette voie vers un “ailleurs” que nous avons tous mais auquel nous faisons rarement de la place.
Vous précisez qu’au Kwilu vous avez accompagné le surnommé D. dans le cadre de ses recherches. Donc, l’objectif était, selon vos mots, de poser votre regard sur le sien. Mais, tout au long de la lecture nous avons l’impression que vous avez posé votre regard sur ce que vous voyiez, et non sur le regard de votre ami. Comment expliquer ce changement ?
Je ne l’explique pas vraiment. Je crois que D. m’a emmenée avec lui parce que c’était lui, en fait, qui me regardait, et qui voulait voir comment j’allais rencontrer cet espace qu’il avait déjà traversé. Peut-être aussi qu’en voulant poser mon regard sur le regard de D., je me suis retrouvée face à moi-même : peut-être qu’au fond, on ne parle jamais que de soi.
Vous dites à la page 28 : “Je suis émerveillée par la capacité de Kinshasa de nous tromper”. Est-il impossible de définir cette ville ?
La vraie violence de Kinshasa pour moi est dans les écarts économiques énormes, dans les cloisonnements que cela crée, les cassures. Kinshasa échappe complètement aux définitions. Il est impossible de comprendre cette ville, bien sûr quand on est Européens (ou même étranger tout court), mais je crois que c’est aussi le cas de certains Congolais eux-mêmes, c’est ce qui fait que les Kinois aiment tellement leur ville. Pour moi, Kinshasa est un animal mythique, qui aurait pris la forme d’un labyrinthe géant qui se métamorphoserait en permanence, dont les parois bougeraient tout le temps. Rien n’est jamais figé à Kinshasa. C’est peut-être là sa permanence. Ce mouvement permanent donne l’impression d’un chaos, d’une instabilité, d’une précarité aussi parfois. C’est faux, selon moi. Ce ne sont là que des images. On construit, à Kinshasa, et on construit beaucoup. C’est une ville qui se réinvente tout le temps. Comme une image qui danse. Comme il est impossible de définir Kinshasa, de la figer dans une image reconnaissable, Kinshasa nous trompe toujours, car l’esprit humain veut toujours s’accrocher à des images fixes, des définitions rassurantes : on se berne soi-même. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime tant cette ville : tout est remis en jeu tout le temps. Cela demande une énorme faculté d’adaptation et beaucoup d’humilité.
Il y a une figure qui revient sans cesse comme un écho : c’est celle de votre maman. A quel point elle vous a influencé ?
Je le dis à un moment dans mon livre : ma mère a fait de moi « son double perdu ». Elle a été ma plus grande force, un très grand amour. Elle est décédée en juin dernier, juste avant de venir à Kinshasa. Ça a été un coup de tonnerre dans ma vie. L’écriture du livre était finie, je lui en avais lu quelques pages, qu’elle avait beaucoup aimées. J’ai beaucoup pensé à elle au moment de la publication. C’est un de mes grands regrets qu’elle n’ait pas vécu ça avec moi. Ce livre lui doit énormément. Elle avait une personnalité et une puissance de parole extraordinaires, en même temps qu’un amour hors-norme pour ses enfants. Et à la fois, elle pouvait nous blesser par ses mots quand elle souffrait trop. Le monde a été très injuste avec elle : on n’accepte pas toujours d’entendre la vérité ni l’intelligence, et ma mère a beaucoup souffert de cela. Elle aussi était, relativement, inadaptée aux codes, même si elle les avait très bien compris et qu’elle les maîtrisait. Mais elle mettait la vérité et le courage au-dessus de tout, et elle ne faisait aucun compromis. C’était une femme qu’on ne pouvait pas faire céder, jamais. Qui ne pliait pas. Et qui détestait la médiocrité intellectuelle. Elle mettait l’intelligence, le courage et la générosité très au-dessus du reste. Elle m’a transmis tout cela. Une forme d’intransigeance. Ce n’est pas toujours facile à vivre ! Et il y a un prix à payer, celui d’une certaine solitude parfois. Mais c’est le prix pour être fidèle à soi-même, et la vie vous le rend en vous faisant rencontrer des personnes et vivre des expériences extraordinaires.
Vous soulevez une idée selon laquelle la mémoire du colonisateur est trouée des blancs. Est-ce qu’aujourd’hui il y a des preuves qui montrent que le colonisateur a du mal à se regarder ?
Toutes les institutions en sont la preuve : il n’y a qu’à lire leurs discours. Trop d’intérêts (économiques et politiques) sont encore en jeu et le capitalisme est aujourd’hui généralisé, même en Chine et en Russie. Dans des pays où les Etats sont autoritaires, ils utilisent les mêmes structures économiques que les Etats occidentaux. Au-delà des institutions, il est difficile aussi d’en parler avec la plupart des Européens, qu’ils vivent en France ou en RDC. Je crois que la période est encore très récente : la mémoire est encore traumatisée. Peu se rendent compte de ce que la France (entre autres) doit à cette sombre histoire des colonisations. Quand ils ne sont jamais venus au Congo (ou plus généralement en Afrique, mais je ne sais pas si cela a le même sens dans d’autres pays), ils n’imaginent pas un seul instant la réalité d’ici, ce qui est normal en même temps. Je me souviens de ma mère, qui me disait, quand je me disputais avec elle au sujet de ses représentations fausses du Congo : « Mais je lis des livres, je regarde des émissions ! » Les médias en France nourrissent une vision complètement fausse de ce pays, comme d’un pays pauvre, un chaos, un pays de violence. C’est faux. Je reviens d’une semaine de travail au Kasaï central, j’ai été magnifiquement accueillie, avec une gentillesse rare, et beaucoup de douceur. Mais on ne peut pas le savoir qu’on est pris dans des images, quand on n’a jamais vécu en Afrique. Pour ceux qui vivent ici, particulièrement au Congo, la difficulté est de sortir des espaces réservés aux expatriés, qui offrent un confort très séduisant, même si c’est parfois un peu étouffant et frustrant d’être toujours « entre soi ». Certains sortent, rencontrent des Congolais, vont dans les quartiers populaires mais parfois c’est pire, cela devient une sorte d’exploit, ils chiffrent leur connaissance du pays en nombre d’années, ce qui n’a aucun sens, ou alors ils vont toujours aux mêmes endroits, et, sans s’en rendre compte, adoptent une posture haute, en donnant des leçons et en émettant des jugements moralisateurs ou condescendants. Il faut dire aussi que certains Kinois jouent un double jeu à ce niveau, et colportent eux-mêmes une image fausse de la ville, voire du pays, toujours celle du chaos, de la désorganisation, de la dangerosité. C’est un peu comme un jeu de dupes, dans les deux sens. Il est extrêmement difficile de sortir de ça. Kinshasa demande beaucoup d’humilité, beaucoup de remise en question. Cela implique une capacité à prendre des risques, dont celui de ne pas comprendre, de ne pas maîtriser, de s’interroger véritablement, et pas de faire semblant de le faire. Pour moi, c’est là que les artistes et les intellectuels jouent un rôle essentiel : ils pensent et représentent ce qui n’a pas encore de place dans les esprits, car c’est un innommable, un impensable. Ils rendent sensible et audible ce qui ne peut être admis par la raison, encore moins pas la pensée dominante, encore moins par les institutions actuelles.
A Kikwit, vous avez été saisie par les choses que vous n’arriviez pas à comprendre ni à nommer. Cette observation vous pousse à dire dans le livre que “l’écriture commence peut-être dans l’inaperçu”. Comment expliquer ce rapport avec l’invisible ?
Je crois que l’écriture (et la création en général) font apparaître et entendre ce qui ne se voit pas, ce qui ne s’entend pas, ne se dit pas. Comme disait Godard : « Cela s’écrit, cela se peint, cela se compose ». C’est quand l’esprit vacille, se retrouve dans une véritable obscurité, que peut se faire la rencontre et que peut commencer la création. C’est peut-être un rapport avec « l’invisible ».
Selon le rapport de 2022 de la Banque mondiale, la RDC est parmi les pays les plus pauvres de la planète. Pourquoi selon vous, cette expression n’est pas appropriée ?
Parce que la RDC est un pays extrêmement riche, par ses ressources en minéraux et la richesse de ses terres. C’est aussi aujourd’hui le premier poumon de la planète. C’est un trésor de l’humanité, à sauvegarder, à protéger, à cultiver. Mais, pour ces mêmes raisons, c’est aussi un pays qui attire les convoitises de toutes les exploitations. Et c’est ce qu’on appelle le peuple qui en souffre. Oui, il y a une réalité économique, qui est très dure pour de nombreuses personnes, qui se battent au quotidien pour quelques dollars. Mais je ne suis pas d’accord pour que l’on définisse des gens par cet adjectif : « pauvre ». Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est un terme économique. Or, une personne ne se réduit pas à son statut économique, ne se définit pas seulement par ça, et surtout, un statut économique peut changer. N’oublions pas également que la richesse de certains pays repose sur l’exploitation de ces pays qu’on appelle « pauvres » : alors, où est la richesse ? Où est la pauvreté ? Enfin, ce qui pour moi est un vrai scandale intellectuellement (et humainement), c’est que cette qualification de « pauvre » maintient les gens dans une position minoritaire, de gens qui ont besoin d’être aidés, formés… C’est très pervers, un peu comme avec le statut de victime. Si vous maintenez tout le temps quelqu’un dans l’idée qu’il ou elle est une victime, il ou elle ne s’en sortira jamais. Cela crée une dépendance très aliénante.
Bien que le français soit un héritage de la colonisation, un outil de domination, mais, selon vous, sa position est le point faible des Européens. Dans quel sens ?
Oui, parce que, dans un pays francophone comme la RDC, on croit, quand on est Français, qu’on maîtrise l’espace, puisqu’on maîtrise la langue. Or, c’est faux : les langues de cet espace, celles qui structurent sa mémoire et sa vie quotidienne, ce sont le lingala, le swahili, le tshiluba, le kikongo, sans parler des langues plus locales. Les Congolais maîtrisent les deux (et le plus souvent en maîtrisent même trois, voire plus). La très grande majorité des Européens n’en maîtrisent qu’une (le français, en plus de leur langue).
Peut-on dire que ce livre est pour “décoloniser” certains Européens ?
Je n’ai pas cette prétention. Encore une fois, chacun est responsable de ses représentations et de sa mémoire, et de ce qu’il ou elle choisit de construire avec son héritage. Mais il est vrai que je m’adresse en grande partie aux Français, comme moi, qui portent ces récits manquants, qui, inconsciemment, sont aussi des blessures. Aussi parce que je suis convaincue que les Français peuvent entendre ça. Que cela va aussi nous libérer d’une sorte de chape de plomb qui nous prive d’une partie de nos propres mémoires.
J’ai grandi en partie en Ariège, je passais quasiment toutes mes vacances chez ma grand-mère. L’été dernier, quand j’y suis retournée, après l’enterrement de ma mère dans son village natal, j’ai ressenti que j’étais moi aussi une diaspora (cela m’a fait sourire d’abord) : j’ai des racines là, mais j’ai grandi et j’ai été formée ailleurs. Et pourtant, encore une fois, mes racines sont dans cet espace-là. Ma grand-mère me parlait parfois dans ce qu’on appelle le patois, qui est un autre mot pour désigner une langue locale, comme le dialecte. Je ne sais pas quel était le nom de ce patois, d’ailleurs. Je crois qu’avec cette langue, même si je suis incapable de la parler aujourd’hui, elle m’a transmis la terre. Ce qui est amusant, c’est que ma mère était professeure de français, donc dans une approche très académique de la langue, le français ayant déjà colonisé, en quelque sorte, le territoire français, après le Moyen-âge, en commençant par imposer la langue française dans toutes les administrations, avec l’édit de Villers-Cotterêts, signé en 1539 par François 1er. Or, moi aussi je suis devenue professeure de français, mais mon frère, lui, a choisi, depuis des années, de défendre l’occitan (qui serait un peu comme le kikongo pour le Kongo central et le Bandundu). C’est-à-dire les racines. Je vois cela très différemment aujourd’hui, je le comprends. En même temps, je ne crois pas qu’il s’agisse de supprimer le français. Cela n’aurait aucun sens, même, car cela a donné lieu à une grande littérature (entre autres). C’est aussi notre langue.
Cette réflexion fait partie de celles que m’a inspiré ce pays.
Julie Grimoud : professeure de français et écrivain
Interview
Me Merveille Mulamba : “la paix, un capital social important pour l’épanouissement de la femme”
Interview
Julie Grimoud : “les médias en France nourrissent une vision complètement fausse de la RDC”
Lors de la cérémonie de prestation de serment jeudi à Kinshasa, les inspecteurs des finances ont pris l’engagement de travailler avec dévouement, loyauté et intégrité pour la nation congolaise.
Des avocats mandatés par Kinshasa affirment, dans une mise en demeure, que la firme américaine utilise des minerais “importés par contrebande” au Rwanda.
Taux de change
| Devise | CDF |
|---|---|
| 1 Dollar Usa | 2,765.00 CDF |
| 1 Euro | 2,944.45 CDF |
| 1 Yuan | 381.95 CDF |
| 1 FCFA | 4,52214 CDF |